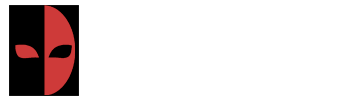Une tribune

Il faut un peu de culture historique pour oser comparer, comme l’a fait D Schneiderman récemment dans Libération, la tribune des 100 femmes « libres d’être importunées » à la réaction thermidorienne de juillet 1794. Il en irait selon lui de ces 100 femmes (et des autres qui leur ont succédé sur les plateaux de télé) comme des membres de l’ancien régime qui étaient ressortis «des caves et des cachettes en n’en revenant pas d’être sortis vivants» de l’épisode révolutionnaire. A son tour donc, la libération d’une parole de femmes ne se reconnaissant pas dans la violence des #MeToo ou #balancetonporc a pu se produire.
Ce sera finalement de la France, via la notoriété de Catherine Deneuve, que sera venue cette réaction que n’ont pas manquée de signaler les journaux étrangers qui en ont fait leur manchette. Il faut s’en réjouir. La libération de la parole ne peut être à sens unique. La société civile française que les adeptes d’un trop rapide consensus accusent régulièrement de passer son temps à se déchirer a aussi la grande force d’aimer le débat politique. Cela laisse moins de chance au déni de s’installer.
Désaccord
A cette tribune, on peut commencer néanmoins par s’opposer.
La « liberté d’être importunée » par exemple, entraîne une confusion entre drague lourde et harcèlement. On a tous été témoin (voir acteur ?) de ces dragues lourdes, dont on sait à quel point la frontière avec une forme de harcèlement est ténue. C’est précisément le sujet que de travailler à préciser cette limite, à reparler de consentement, du regard sur l’autre, de l’altérité, voir de la pudeur.
Reparler de consentement, de regard sur l’autre, de l’altérité
Par ailleurs, dénoncer le harcèlement n’est pas apporter de l’eau au moulin des extrémistes religieux. On peut être d’accord au contraire avec toutes les femmes, d’une tribune à l’autre, pour dire que le voile constitue une façon régressive et illusoire de résoudre le problème de harcèlement dans la sphère publique si ce n’est en le déplaçant dans la sphère privée.
Accords
Au delà de ces régressions argumentaires déjà pointées à sa façon dans la brillante réponse de L Slimani, il y’a pourtant dans cette tribune des contrepoints dignes d’intérêt.
Un déli d’incitation au harcèlement des femmes
Chacun l’avait pressenti, censurer l’expression artistique en l’épurant de toute forme de représentation des pulsions reviendrait quasiment à la solution du voile citée plus haut. La seule limite discutable, à l’instar de l’interdiction des « provocations et incitations à la haine raciale » serait un délit d’incitation au harcèlement des femmes.
De façon plus piquante, cette tribune met l’accent sur un point dont il n’avait été question jusque là. La victimisation ou le glissement vers un statut de victime est en effet un problème qu’elle dénonce franchement.
Statut de victime et déni
Ce statut, et le discours qui l’accompagne, contribue paradoxalement au déni. Ce discours n’est pas réservé aux victimes de harcèlement sexuel. Il résulte de la mise à jour de tout ce qui était étouffé jusque là, sexuel ou non. Mais c’est encore plus violent quand il s’agit de sexe. Il est alors relayé par des associations ou autres mouvements qui vont structurer ce discours et fixer ce statut pour des raisons de lisibilité médiatique et politique. C’est le stade indispensable de la radicalité du discours déjà abordé avec actup.
C’est aussi le risque de recouvrir la singularité de chaque histoire, en la récupérant en quelque sorte, en la dénaturant aussi du même coup, ce qui peut boucher sa capacité à se résoudre. C’était tout l’objet du débat retentissant entre C Angot et S Rousseau.
Statut de victime et culpabilité

De plus, ce discours occulte la question, particulièrement épineuse, de la culpabilité dans le parcours de chaque victime. Oser questionner ouvertement sa part propre permet d’intégrer cette culpabilité et de ne pas la laisser faire son silencieux travail de sape.
Ainsi, les propos de B Lahaie sur la jouissance de la femme violée ont fonctionné comme un lapsus, une irruption d’une pulsion inconsciente. Après le choc légitimement insupportable qu’ils ont provoqué (l’inconscient est difficile à supporter), ils ont (involontairement) permis de mettre à jour une pulsion, potentiellement présente dans l’inconscient de chacun. Le fameux syndrome de Stockholm par lequel une victime d’enlèvement pactise avec son ravisseur n’en est qu’une autre forme.
Cette pulsion est très bien exposée dans les films « Elle » de P Verhoeven ou « Jeune et jolie » de François Ozon. Ces cinéastes, connus pour oser affronter l’ambivalence et la sauvagerie des pulsions, ne contrediraient pas Freud (parlant de l’inconscient) quand il disait que « l’homme n’est pas maître dans sa maison ». Nous sommes des êtres divisés et le clivage qui en résulte, ne peut trouver plus grande expression que dans cette sensation pour certaines femmes violées de se séparer de leur corps au moment de l’acte et de se regarder d’en haut. C’est également possible pour d’autres femmes dont le consentement n’était ni mûr, ni sûr et qui sont prises de cours, comme cela est très bien montré dans les premières scènes de « Jeune et jolie ».
Une suite peut exister à la culpabilité
C’est à cette division, à cette pulsion de viol si délicate à aborder pour les victimes qu’est pourtant due une grande partie de cette culpabilité injustifiée. Entendre les propos de B Lahaie sont insupportables pour une femme violée car son auteure n’y donne aucune suite. Pourtant, une suite peut exister. Reconnaitre ces pulsions comme n’appartenant pas au « moi » mais imposées au contraire par une instance sauvage (le « ça » freudien) et agir en s’y opposant, soit par des actes, soit par des pensées, si on le peut, lorsqu’elles arrivent ou reviennent.
Voilà une suite qui ouvre à un possible franchissement de la culpabilité et du même coup du statut de victime.
Construire une suite
Casser le déni
Une poursuite heureuse de ce débat public serait pour ces 100 femmes de comprendre que cette étape d’explosion de la vérité, avec ses excès (il y’aura des cas de faux témoignage qui ne devront pas remettre en cause tous les autres) est donc indispensable. Il faut permettre aux femmes harcelées de revendiquer un temps ce statut de victime. Il faut les aider à dire la vérité nue, crue et cruelle.
C Anzieu-Premmereur, psychanalyste commentant la prise en charge des victimes du 11 septembre écrit: « pour parer au risque d’effondrement, il a été important que l’environnement échappe au déni [c’est l’inverse dans cette tribune], reconnaisse la force destructrice et la violence de l’évènement, et offre des possibilités d’élaboration ». Décréter, comme l’ont fait ces 100 femmes, qu’ «on ne peut se sentir traumatisé à jamais par un frotteur dans le métro » est une violence faite aux victimes. Comme s’il était question de paresse à passer à autre chose.
Plus loin: « les accidents qui peuvent toucher le corps d’une femme n’atteignent pas nécessairement sa dignité et ne sauraient faire d’elle une victime perpétuelle ». Comme s’il s’agissait d’une nécessité, étrange, de se sentir toucher dans sa dignité. Retournement de la charge de la honte qui impose à ces femmes une deuxième peine. Très lourde.
Sortir du discours victimaire
Mais une sortie heureuse de ce débat serait aussi pour ces milliers d’autres femmes, celles qui ont été traumatisées, de garder de la lecture de cette tribune controversée que le danger qui les guette est de se laisser enfermer dans un discours victimaire empêchant d’élaborer et de dépasser la question de la culpabilité.
Comment se servir de ce débat ?
Pour tous ceux qui se sentent victimes
Ce débat est sans aucun doute utile à toutes et tous. Il trouve ses prolongements dans bien d’autres situations où la question de la victimisation est en jeu. La compréhension de ces mécanismes peut permettre de guider ceux qui se considèrent comme les victimes d’un patron, d’un collègue, d’un membre de leur famille ou de leurs amis etc… Dans l’entreprise par exemple ou un employé peut s’enfermer dans le burnout et les arrêts maladie successifs.
La seule façon pérenne de sortir de cette situation est d’écouter, de reconnaitre sa difficulté voir sa douleur, lui permettre de l’élaborer, d’y voir quelle part il y a ou non, et de l’aider ensuite à sortir de ce statut de victime. C’est un autre espace temps que celui qui habituellement est consacré à ces individus dans le monde d’aujourd’hui. C’est pourtant un investissement gagnant pour la société comme pour l’individu.
Pour ceux qui souhaitent s’engager (politiquement par exemple)
C’est donc une question politique primordiale. Un clivage politique existe justement sur la façon dont les « victimes du système » doivent être aidées. La ligne libérale et « méritocratique » assume d’en nier les causes comme s’il s’agissait d’un frein à la construction de ces individus, comme si donner de l’importance à leur plainte les confinait dans leur statut de victime. Par ailleurs, ne pas brider une élite qui en contrepartie tirerait vers le haut l’ensemble de la société (la théorie des premiers de cordée).
Il est essentiel pour la gauche d’y répondre autrement. Elle a certes traditionnellement répondu par une plus grande reconnaissance des souffrances des victimes du système (même si elle n’a pas le « monopole du coeur »). Selon ce qui apparait au travers de ce débat sur les victimes sexuelles, et en le transposant un peu audacieusement au parcours de tous ceux qui peuvent légitimement se sentir victimes du système, cette gauche serait avisée de ne pas cantonner ces individus dans un discours victimaire et finalement infantilisant. Elle préviendrait alors les critiques libérales l’accusant de « tirer la société vers le bas ».
Il en va de la responsabilité de cette gauche, nouvelle, de compléter cette faculté de reconnaitre la dureté du réel par des politique redonnant le temps à chacun de travailler à sortir de l’impasse. Par exemple, le revenu universel pourrait constituer un instrument original par la latitude qu’il donnerait à chacun de prendre un peu le temps de passer par les différentes étapes évoquées.
Finalement, on ne s’en rend pas bien compte, mais la France continue de faire sa révolution…