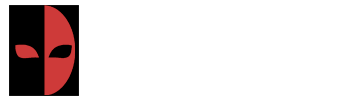Cet article est une lettre adressée à l’écrivaine Beata Umubyeyi Mairesse pour son livre Le Convoi, publié en 2024
Chère Beata,
Je vous ai écouté l’autre soir à la librairie du Contretemps à Bègles parler de votre livre « Le convoi ». Cela fait quelques années que je m’intéresse à l’histoire du génocide des Tutsi au Rwanda. J’avais un ami d’enfance qui s’était rendu au Rwanda dans les années 90. Cela m’avait intrigué à l’époque. J’étais interne en médecine et j’achetais Libé tous les matins au coin de ma rue. Je le lisais vers 7h avant de prendre mon déjeuner et de partir à l’hôpital. Je suivais cette terrible actualité comme un feuilleton géopolitique que cet ami contribuait à rendre moins lointain. Je l’ai recroisé pour la dernière fois en 1997 sans qu’il ne me dise quoi que ce soit sur ses séjours au Rwanda. C’était une amitié spéciale car ponctuée, entre deux périodes complices, de séquences ou moi et d’autres amis de la même cage d’escalier ou nous vivions tous, avions mal réagi à des bizarreries de son comportement … une relation qu’on pourrait aisément taxer maintenant de harcèlement ! Je restais pourtant son ami. Je crois néanmoins qu’une sorte de culpabilité me conduisit rétrospectivement à penser ce voyage au Rwanda comme la confirmation d’un caractère à part. Son retour, par les nouvelles indirectes que j’avais de lui, ne s’était pas bien passé et il avait trouvé refuge chez son père chez qui je crois qu’il vit depuis. C’est comme ça qu’en bon européen insensibilisé, le Rwanda ne restait confusément que comme un conflit où s’était rendu une personne proche dont on ne sait plus si on a été pour lui un ami ou un ennemi ce qui est rétrospectivement signifiant.
C’est en lisant Le Monde plus de 20 ans après ces évènements que j’ai pu mesurer l’ampleur de l’horreur de ce qui s’est passé dans votre pays. J’ai alors beaucoup lu et j’ai été abasourdi par le silence voire le déni de l’Etat français, que seuls le courage d’un lanceur d’alerte, François Graner, puis les actions de Stéphane Audoin Rouzeau et d’autres historiens ou journalistes (comme Patrick de Saint Exupéry dans Libé) ont réussi à briser. Au fur et à mesure que les informations du rapport Duclert – commandé par Emmanuel Macron en 2021 – sortaient, j’ai fini par comprendre qu’une chape de plomb avait été organisée au plus haut sommet de l’Etat. C’est toujours an nom d’une valeur supposée suprême que l’on ferme les yeux sur l’impensable. François Mitterrand fut semble-t-il aveuglé par la défense d’une France post coloniale (incarnée par son soutien au régime Hutu) face à l’Angleterre et son ancienne colonie l’Ouganda qui soutenaient les « rebelles tutsi ». Pour Hubert Védrine, alors Secrétaire Général de l’Elysée, c’est la fidélité au chef de l’Etat qui semble avoir prévalu. Les mécanismes de défense qu’ont employé ces personnages ont donc consisté à nous faire croire qu’il s’agissait d’un de ces multiples conflits tribaux Africains comme vous le relevez dans votre livre. Qu’il s’agissait d’un massacre des uns par les autres et vice-versa, la fameuse théorie du double génocide Rwandais. Tout ceux qui continuent de porter ce regard biaisé « vieilliront mal » dit Serge Hatzfeld qui a lui même interrogé ce silence dans un de ces livres sur le Rwanda « Là ou tout se tait » et permis à des survivants de parler. Il a remis de la parole là ou cette parole manquait.
Le génocide des Tutsi n’est pas le premier évènement de cette ampleur sur lequel je me suis penché. J’ai énormément lu sur la shoah. J’ai visité Auschwitz Birkenau en pleine période covid, évitant ainsi un flux de touriste incompatible avec l’identité de ces lieux. J’ai visité de nombreux autres lieux de mémoire. C’est au point que des amis se moquent gentiment des nombreux pèlerinages que j’entreprends en famille. Je crois savoir pourquoi j’ai développé cet intérêt (certains diraient un peu crûment cette fascination morbide). C’est à la psychiatre Muriel Salmona – dont j’ai lu quelques écrits – que je dois de l’avoir définitivement compris. Elle est spécialiste des troubles psychologiques secondaires à l’inceste, qu’elle a vécu elle même. Or elle a développé une grande sensibilité aux génocides. Elle dit qu’ils sont pour elle « une interrogation face au monde très en lien avec ce qu’elle a subi ». J’ai malheureusement moi aussi vécu l’expérience de l’inceste qui m’a emmené, sans que je n’en sache rien au début, plus de 20 ans en analyse. Qu’ont de commun ces deux expériences, le crime de masse et le crime intime (dont je ne cherche évidemment pas à comparer le degré d’horreur) ? Je crois qu’il s’agit dans les deux cas d’un retournement incompréhensible et terrifiant, contre vous, votre corps, votre vie, de ceux qui hier étaient vos voisins, vos amis, vos proches. Il s’agit d’une rupture au coeur même de votre vie. Je n’ai pas votre expérience d’une situation de survie mais je crois que comme le fait dire Yasmina Reza à son héros Serge dans son roman éponyme, « un savoir qui n’est pas intimement relié à soi est vain ». Votre savoir, chère Béata n’est pas vain pour moi.
Mais je ne vous ai pas dit encore le principal, parce que votre livre recèle pour moi quelque chose de plus, quelque chose qui ré-sonne. C’est dans les dernières pages que je l’ai lu, même s’il constitue le fil rouge du récit. Deux des trois psychanalystes qui étaient parmi vous l’autre soir à la Librairie l’ont fait remarquer, dans un contretemps (comme la librairie) propre à leur discipline. L’un en notant l’équivoque langagière du titre « le qu’on voie (convoi) », l’autre en vous demandant si vous comptiez écrire, non pas une suite comme une série à épisode, mais une suite car vous n’avez peut être pas encore tout dit. Ce qui a résonné donc, c’est la question de cette image manquante, la pièce centrale de votre puzzle personnel. Avec justesse dans cette dernière partie, vous abordez la question des photos prises par les autres, sans votre consentement ou le consentement de leur sujet, accompagnées de sous-titres le plus souvent inexacts ou trompeurs. Comme un sujet en analyse qui se met lui aussi après des années de recherche à contester les sous titres mis par les autres. Plus précisément par le grand Autre, une invention conceptuelle Lacanienne pour dire cet autre en soi qui condense le langage comme une bibliothèque de mots et d’expressions prêtes à l’emploi. A contre emploi souvent malheureusement, comme vous le sentez bien avec ces sous titres dont le seul effet est de gommer votre subjectivité, de vous la voler même. La différence c’est que le sujet au début de son analyse ne sait parfois même pas ce qu’il cherche. C’était mon cas et ayant évoqué la personne en cause dans la scène subie, j’étais incapable de nommer l’inceste et je ne faisais que balayer cette image comme on tourne négligemment les pages d’un album photo de famille. Depuis que j’ai nommé ce qui m’est arrivé, je ne peux pour ma part plus consulter les albums de photo de toute l’époque qui a précédé ce savoir.
Voilà qu’on vous parle maintenant d’un sourire, le vôtre pendant cette épreuve du convoi, qu’un témoin aurait gardé comme souvenir de vous. Cette petite fille que vous cherchez sur la photo aurait-elle souri à l’objectif alors qu’elle souffrait au subjectif ? Ne vous aurait-on pas ôté aussi la nature de votre ressenti ? Comment réagiriez vous si ayant finalement trouvé cette photo vous vous retrouviez souriante dessus ? Je n’ai pas cherché – au même sens que vous – la photo manquante du traumatisme. Pour moi il se serait agi d’une photo d’un jeune garçon apeuré sortant d’une chambre. Qu’y aurais-je vu de plus ? Je me rappelle avec précision de ces moments bien que, comme vous, le décor se soit quelque peu dissout. Je n’ai pourtant de l’affect qui était attaché à ce moment qu’un souvenir reconstruit, comme si un autre que moi l’avait vécu, comme si je regardais une photo sur laquelle je me voyais sans ne plus rien ressentir. Aucune angoisse notamment. Il a fallu à celle-ci se frayer un chemin et ressortir sous forme d’une phobie dirigée contre d’autres personnes. C’est donc un peu mon image manquante, je l’appelle mon masque. Je ne la cherche pas car la photo n’existe pas mais je peux tout à fait comprendre à quel point elle est importante pour vous. Seulement, qu’apporterait cette image ? Que prouverait elle ? Qu’avons nous encore à (nous) prouver pour sortir de nos traumatismes ?
Peut être cela dépend-il du symptôme ? C’est d’ailleurs ce qui m’intrigue en vous lisant car vous ne parlez pas de symptôme. Comment votre vécu a-t’il traversé le temps et comment se manifeste-t-il encore ? Que ressentent concrètement les personnes qui ont traversé ces épreuves ? C’est évidemment subjectif et on en a un petit aperçu en lisant les paroles des rescapés qu’interroge Jean Hatzfeld dans son livre. Revivre en compagnie de ceux qui ont participé au génocide de vos proches ne peut se vivre sans symptôme. Sinon, pourquoi « tout pardon [resterait-il] impossible » comme le dit l’une des personnes qu’il a interrogée. Peut on un jour revivre ensemble ? L’actualité en Palestine et en Israël nous repose cette question, encore une fois. Le symptôme chez moi, je vous l’ai dit, c’est la survenue d’épisodes phobiques ou le masque uniforme et impersonnel vient s’interposer entre moi et n’importe quel proche, au point d’engendrer un recul angoissé. Je me suis demandé si mon image manquante, cet affect disparu seulement imprimé sur la photo que j’ai en tête, aurait permis à ce masque de tomber plus facilement et surtout définitivement. Il me faut encore combattre aujourd’hui avec la partie de moi même qui se défend, ce grand Autre qui mine en permanence la reconnaissance de la gravité des faits, le combattre à l’aide d’une logique inexpugnable, celle qui relie cette image manquante à mon symptôme d’aujourd’hui.
Chère Beata, je mesure le combat que ce livre décrit pour obtenir la reconnaissance des faits. Je mesure la souffrance que les autorités françaises, incarnées à leur pointe encore aujourd’hui par l’odieux personnage d’Hubert Védrine – toujours invité sur les plateaux de télé pour donner son avis sur tel ou tel conflit ! – vous assènent en éludant la vérité et donc leur responsabilité réelle. Cette photo a pour vous certainement une valeur symbolique comme cette logique l’a eue pour moi. Que vous la retrouviez ou non, vous écrivez. Et, ce faisant, vous redonnez au symbolique sa juste place face au réel qui vous a percuté et à l’imaginaire que vous en gardez.
Cela guérit, progressivement mais sûrement.
Alors merci.