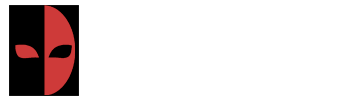30 mars 2020 Recherche
A
Au cours de cette crise, on m’a confié la responsabilité de la recherche clinique en réanimation sur le Covid-19 au CHU de Bordeaux. Passées les deux premières semaines à organiser, préparer, prendre en charge les patients atteints de pneumonie, une énorme ébullition s’est emparée du monde de la recherche.
La réanimation est une discipline jeune et je me fais parfois la réflexion que j’ai eu la chance de connaitre les fils des pionniers. J’appartiens donc à la troisième génération des réanimateurs. Et je suis supposé poursuivre le travail de mes ainés. J’ai eu la chance de côtoyer l’un des plus grands chercheurs en la matière. J’ai été un des assistants de son service en région parisienne. J’avais une grande admiration pour la maîtrise clinique et la recherche essentiellement fondamentale menée par ce médecin. Il avait notamment démontré comment un ventilateur pouvait amener des lésions pulmonaires supplémentaires à un poumon déjà bien lésé par une infection. Quasiment tous les réanimateurs avaient suivi les nouveaux réglages de ventilation qui se déduisaient de ses travaux. Rien ne pouvait donc laisser prévoir ce à quoi j’ai assisté un jour. Nous participions à une étude très innovante, de celle que l’on ne confie qu’aux services très experts. Il avait évoqué avec nous l’intérêt de participer à cette étude mais ne nous avait pas caché son danger. Il s’agissait de verser un liquide dans les poumons d’un patient endormi et ventilé pour une pneumonie grave. Ce liquide avait la propriété d’échanger le gaz carbonique et l’oxygène de façon très efficace. En versant ce liquide, nous espérions qu’il remplirait les alvéoles pulmonaires infectées et améliorerait immédiatement les échanges gazeux. Pendant les quelques jours qu’a duré cette étude, le service était en état de crise. Tout le monde était sur le pont. Nous restions après nos gardes et le patron restait lui aussi tard le soir. Nous avons commencé à inclure les premiers malades. Je ne me rappelle plus exactement au bout de combien de patients nous avons constaté des difficultés d’oxygénation plus importantes que prévu au moment où l’on remplissait les poumons, mais ce fut rapide. Par contre, j’ai un souvenir très clair du visage défait et inquiet de mon patron, de l’agitation incroyable qui animait cet homme d’habitude si contrôlé. Il avait eu besoin de nous prendre à témoins dans son bureau dont la porte restait pourtant exceptionnellement ouverte. Le téléphone posé sur la table, nous entendions la conversation houleuse, en anglais, qu’il avait avec les investigateurs américains qui, de leur côté, voulaient continuer l’étude. Nous l’avons ce jour-là stoppée et elle n’a finalement donné aucun résultat. Ce fut le premier témoignage de la responsabilité que nous, médecins et chercheurs, avions dans le domaine de la recherche clinique.
Ces derniers jours, alors que je suis dorénavant dans la position de celui qui endosse ces responsabilités, je suis passé par plusieurs états. Dans un premier temps j’ai cédé à une sorte d’hystérie collective. Une énorme pression s’est abattue sur nous : une épidémie est un fléau qui change nos rapports à la maladie. Multipliant par dix notre volonté de la combattre, nous nous transformons tous en chevaliers vengeurs. La maladie est annoncée partout, nous sentons le souffle de la vague avant même qu’elle n’arrive, nous sommes en proie à l’émotion et surévaluons notre rôle. On nous appelle des héros, ce qui n’est pas de nature à calmer ce sentiment. Nous oublions que les meilleurs armes sont la raison. Tout ceci part d’un tel un bon sentiment qu’aucune alarme ne ne nous indique que nous faisons faux chemin. J’ai donc comme d’autres collègues accepté voir même défendu l’attitude consistant à utiliser l’hydroxychloroquine et d’autres traitements antiviraux. Nous ne savions pas bien ce que nous faisions et changions d’attitude quant aux doses prescrites ou aux façons de surveiller ce traitement tous les deux jours. J’ai même personnellement participé à une grande réunion de synthèse au CHU dans laquelle j’ai défendu cette attitude sans beaucoup de recul, enivré de sentir tous ces regards portés sur moi, le combattant de première ligne.
L’affaire Raoult a paradoxalement permis de réfléchir. Dans le monde scientifique médical tout le monde connaît le personnage et c’est un sentiment contradictoire d’admiration pour ce chercheur reconnu et de scepticisme devant sa mégalomanie qui nous a animé au cours des journées que je viens de décrire. Raoult écrit qu’à une médecine scientifique laissant soi-disant trop de place à des mathématiciens (c’est comme ça qu’il appellent les méthodologistes et les statisticiens), il oppose et préfère la médecine de Tom. Tom est le fils d’un confrère qui défendait la médecine qu’il pratiquerait si le malade n’était autre que son fils: tom.
Des Raoult on en est constamment entouré. Cela fait plus de 20 ans que je travaille à l’hôpital et j’en ai toujours croisé où que je travaille. Je pratique moi-même aussi parfois la médecine de Tom. Je me suis surpris dernièrement, et mes collègues n’ont pas hésité à la relever, à critiquer une décision éthique en évoquant la possibilité que la personne concernée ne fût leur fils. Je suis interniste de formation initiale et la médecine interne c’est un peu la médecine de Tom. Les maladies sont tellement rares qu’il est très difficile de réaliser des études de niveau scientifique suffisant pour vérifier la valeur des différentes prises en charge. C’est pourtant une très belle médecine fondée sur des intuitions et surtout sur l’expérience. C’est une science empirique et elle est à ce titre éminemment respectable. Néanmoins pendant mon parcours j’ai fait un stage d’internat dans un service de médecine intensive réanimation et, si j’ai aimé cette discipline, c’est justement parce qu’elle avait les moyens de vérifier scientifiquement les impressions ou les intuitions de ses meilleurs médecins. À une medecine empirique venait donc s’ajouter une science expérimentale.
C’est au fond grâce à ce parcours personnel qu’une question d’éthique de la recherche m’est rapidement apparue en arrière-plan de l’affaire Raoult. Pendant l’épidémie d’Ebola il y a quelques années, la stratégie de Tom a prévalu. Chacun y est allé de son traitement antiviral, de son miracle ou de son espoir. La maladie ravageait des pays dans lesquels l’empirisme et le mysticisme sont des piliers importants et respectables de la vie quotidienne. Et on n’en est malheureusement resté là, aucune étude n’a eu le temps d’être organisée et aucun progrès scientifique n’en est réellement ressorti.
Les grands revues médicales ne nous aident pas puisqu’elles publient ces derniers jours des expériences, réalisées sur une poignée de patients, des adeptes de la stratégie de Tom. Ils croient à une thérapeutique, ils l’appliquent à une dizaine de malade et ils en publient les résultats favorables. En 15 jours donc, on peut arriver à des publications qui, en temps normal, nécessitent des années de travail et peuvent fournir une reconnaissance nationale et internationale définitive. Quelle force morale faut-il alors avoir pour prendre le temps de mettre au point une étude expérimentale ? De celle qui sont pourtant les seules à prouver efficacité réelle d’un traitement.
Je pense souvent à mes collègues assistants de ce service parisien ou nous avons fait nos armes et qui sont devenus des amis chers. Une amitié dont j’ai particulièrement besoin en ce moment. L’un d’entre eux est chef de service de réanimation d’un autre CHU et est aux prises comme moi avec les mêmes questions éthiques, l’autre est pneumologue mais a repris du service dernièrement dans sa clinique de région parisienne pour traiter les malades covid 19 qui affluent. C’est peut-être en souvenir de ce que nous avons vécu dans le bureau du patron ce jour là que j’ai pris la décision de freiner la médecine de Tom covid-19 dans mon unité . Nous sommes revenus aux fondamentaux de la pratique de réanimateur. Nous faisons ce que nous faisions il y a encore un mois: le juste soin au moindre coût. Nous sédatons les malades mais pas trop, nous les tournons sur le ventre sans arracher les cathéter ou la sonde d’intubation, nous les ventilons sans abimer leur poumon, nous faisons attention à la nutrition, leur mettons le moins d’antibiotiques possible, nous recherchons des complications infectieuses et nous essayons de patienter en attendant l’heure ou le poumon cicatrise suffisamment pour respirer seul. Nous faisons aussi venir leur famille. Nous ne leur donnons plus de traitement miracle mais nous les incluons dès que possible dans les études qui permettront peut-être demain d’éviter toutes ces morts insupportables.