Contexte
Maintenant que le déni climatique semble levé comme en témoigne la conversion générale à l’écologie, est-il seulement utile de sy’ étendre ? Cette conversion devrait me réjouir. Quand en 2002, Chirac a « regardé notre maison brûler », j’avais déjà en effet déposé plusieurs bulletins verts dans les urnes. De même, si Greta Thunberg était ma fille, je n’aurais pas à détourner les yeux, ce que fit finalement Chirac, malgré ses préventions, comme tous les autres. Mais voilà, en 30 ans, cette idée, comme toute idée provocante selon Schopenhauer, « a été ridiculisée, puis a subi une forte opposition [elle la subit encore !] et enfin a été considérée comme ayant toujours été une évidence« . Une évidence, oui, quand on regarde le résultat récent des Européennes. En France, les verts n’ont pas vraiment fait mieux que précédemment mais ils ont été hissés au statut de vainqueur en tant qu’unique surprise du scrutin. Peut on en déduire que le combat est gagné, que la conversion est « en marche » ? Laissez moi en douter.
Climato-scepticisme: origine et raison du maintien
Le climato-scepticisme n’est peut-être plus la coordonnée principale du déni climatique en France. Incarné par Claude Allègre dans les années 2000, il est néanmoins toujours solidement installé à l’étranger avec Trump, Bolsonaro, Poutine. Orchestré initialement par l’American Petroleum Institute, ce premier acte du déni a lui aussi 30 ans. C’est lui qui installe une défiance vis-à-vis du climat en même temps qu’un climat de défiance à l’encontre de qui osera critiquer le modèle productiviste* de croissance. Ce modèle si difficile à critiquer car il a temporairement sorti une importante population de la pauvreté économique. Les chantres de ce modèle, les USA d’après-guerre, sont dorénavant face à ce défi du réel et auraient pu, comme l’écrit Bruno Latour dans son livre Où atterrir « devenir réaliste en emmenant le monde libre loin de l’abîme, ou s’enfoncer dans le déni ».

Plusieurs éléments ont concouru à ce déni et participent à son maintien.
D’abord la lenteur du phénomène de réchauffement climatique qui empêche sa perception claire. C’est la mithridisation de la pensée, en référence à ce processus biologique naturel qui empêche toute réaction de l’organisme du fait de doses infinitésimales de mal.
Puis la dilution. Dilution de l’idée écologique dans un vaste, nouveau et dangereux discours marketing. Un exemple: en 2007, surfant sur la vague verte, la société « British Petroleum » utilise opportunément ses initiales BP pour un projet appelé « Beyond Petroleum » laissant penser que cette entreprise, au logo opportunément devenu vert, était prête à un nouveau contrat environnemental. En 2010, elle est pourtant responsable de la plus grande catastrophe écologique du golfe du mexique. La réalité s’est rapidement rappelée aux cyniques et aux naïfs qui les ont crus. Comme le dit Emmanuel Carrère dans son livre Il est avantageux d’avoir ou aller, relatant cet épisode symboliquement lourd, elle se rappelle inexorablement tous les jours aux plus fragiles, puisque « les chômeurs ne sont pas « beyond » le chômage, les pauvres « beyond » les traites à payer » etc.. Passer « au-delà » (beyond) nécessite de changer au préalable quelque chose du réel, une étape jamais envisagée par le marketing de ces entreprises mondialisées.
Troisième élément, l’invisibilité. L’ennemi n’est pas vraiment identifiable. Dans les rares cas où il l’est comme dans le procès Monsanto, il est encore invisible, désincarné, protégé derrière ses avocats. Enfin, cette névrose et en son coeur ce déni, ne seraient pas complets sans une forme de procrastination contenue dans les propos fatalistes qu’on entend encore parfois « on n’y peut rien, ça va s’aggraver quoi qu’on y fasse ». Rappelons-nous pourtant que le fameux trou dans la couche d’ozone, une des premiers trous bouchés dans notre conscience écologique, s’est considérablement réduit suite à l’interdiction des produits dégageant des gaz à base de chlore.
Prise de conscience incomplète
La conscience écologique, du moins en France semble donc avoir atteint un premier palier. Mais quelque chose se maintient. Quelque chose qui nous impose de voir sans voir, savoir sans savoir. Quelque chose de profondément ancré en chacun de nous. Quelque chose qui, dans une conversation entre amis, peut nous faire glisser de la nécessiter de prendre son vélo plutôt que sa voiture pour aller faire ses courses, tout en comparant les meilleurs prix pour aller passer 3 jours à Milan ou à Londres en avion le we suivant. Plus généralement, ce qui se maintient dans une volonté assez générale de conserver ou de concilier libéralisme et écologie. Que le couple Macron Cohn Bendit incarne. Que la rupture Macron Hulot consacre.
C’est comme ça que nous nous retrouvons petit à petit face au pire. Mais pas encore au « tipping point », ce point de bascule popularisé par l’économiste Schelling. Un point en deça duquel rien ne change mais où le changement est pourtant déjà inéluctable et qui est souvent franchi trop tard, quand la catastrophe est arrivée. Un évènement peut parfois servir à atteindre ce point. Nous faire mieux voir les liens entre les différents dénis qui nous aveuglent. C’est à un de ces moments précieux qu’on assiste dans le documentaire anti déni d’Al Gore, Une suite qui dérange. Il montre comment la cop 21 n’a peut-être dû son dénouement qu’aux attentats dramatiques perpétrés au même moment dans la capitale française. Comme si les chefs d’état avaient perçu à ce moment-là qu’ils faisaient confusément face au même désordre du monde et que le terrorisme était le symptôme d’une humanité en crise en son sein, comme au sein de la nature.
Alors faut-il attendre ce tipping point ? Ou briser le déni, réaliser et donc agir avant ?
Que faire ?
A ce stade, particulièrement après l’élection européenne, soyons tout d’abord vigilants vis à vis de la grande majorité des partis qui se réclament opportunément de l’écologie. Il faut séparer ce qui tient du green washing de ceux que Guillaume Carbou appelle les environnementalistes. Un problème survient avec le glyphosate ? L’environnementaliste le supprimera. Mais ne remettra surtout pas en cause le modèle de l’agriculture intensive qui a amené à son utilisation. Se dire écologiste et soutenir les accords de libre-échange tels que le MERCOSUR ou le CETA (le bœuf aux hormones argentin n’a rien à envier au bœuf sous antibiotique canadien) est totalement incohérent et révèle ce qui tient d’un discours et non d’une prise de conscience.
Il faut se poser la bonne question. Comment articuler la question écologique avec la question du modèle de libres échange mondialisé et financiarisé ? Comment l’articuler avec la question des inégalités sociales ?
Réarticuler la pensée écologique dans un ensemble plus vaste et cohérent
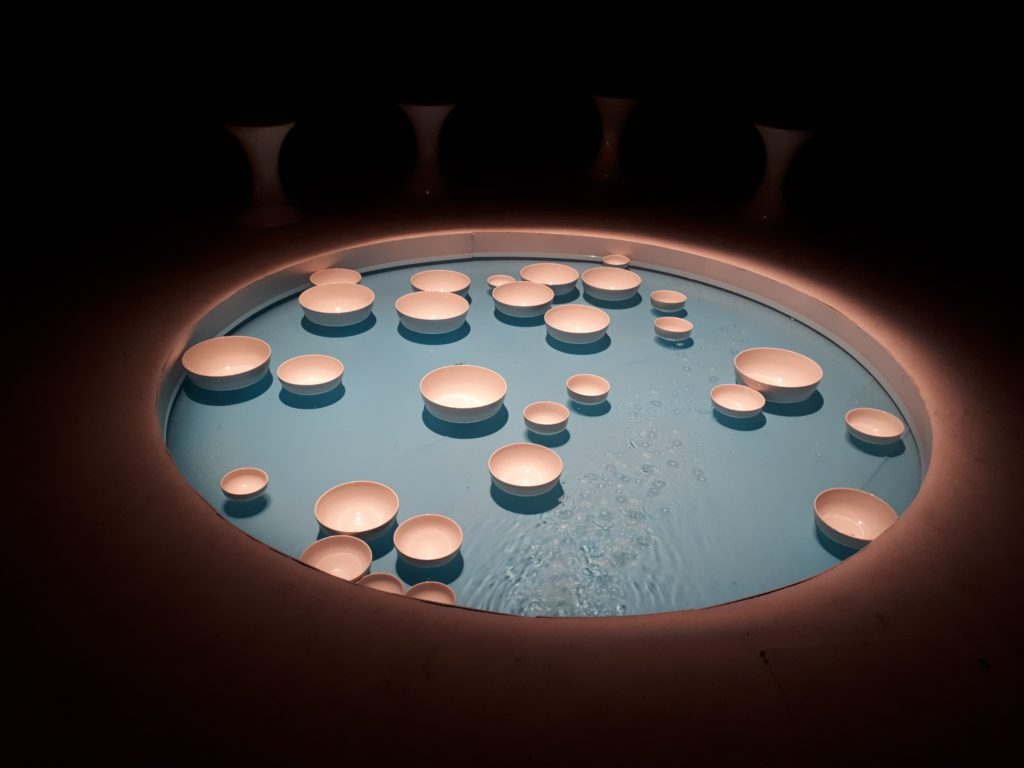
La pensée de réarticulation de Bruno Latour fournit une réponse. Il enterre les anciens clivages droite-gauche et local-global: à leurs extrémités le gauche-local (Larzac) et le droite-local (identitaire) mais aussi, si l’on suit ce plan de clivage, le gauche-global (bobo progressiste) et le droite-global (ultralibéral fan de l’homme augmenté sans frontière). Bruno Latour propose un virage à 90 degrés des plans de clivage distinguant dorénavant les « terrestres » des « hors-sol ». Ce virage nous aide à nous réorienter.
Les hors-sol
Ainsi du « hors-sol » que Trump symbolise à merveille, favorable au libre échange et à la mondialisation tout en conservant une vision de repli sur l’identité américaine (America first) qu’il associe à un déni du changement climatique. Dans cette catégorie on développe volontiers une vision de la nature comme d’une simple ressource qui ne saurait freiner le progrès et la modernité. Il en va de même, autre exemple d’incarnation des « hors-sol », de la conversion écologique des villes de la droite bavaroise ou l’aspiration écologique a pour unique but la préservation de l’authenticité des lac bavarois. Et se mélange avec le rejet des migrants.
Le terrestre
Au contraire, le « terrestre » intègre l’idée de la nature comme d’un sol composé d’agents formant une chaîne de laquelle l’homme ne peut s’extraire. Et qui accepte donc cette complexité. L’exemple de la résistance des bactéries aux antibiotiques et des positions du monde médical en est un exemple**. Il est tout à fait transposable à d’autres champs comme l’agriculture, la pêche, et probablement à toute entreprise dont l’objectif est de s’imposer aux autres au terme d’un processus de concurrence morbide.
Quel anthropocène ?
Bruno Latour poursuit et nous demande de choisir quel anthropocène (la marque de l’homme sur la nature) nous voulons.
Pour le « terrestre », méconnaitre les processus complexes de la nature, c’est méconnaitre la complexité de notre propre nature. Notre « humus épais et profond » dit Bruno Latour qui fait sciemment le lien. Il insiste sur « le suivi rapproché qu’il exige, le soin attentif qu’il nécessite». Il nous parle de nous, comme s’il s’agissait de nous guérir nous même d’une forme d’éloignement de notre nature, comme d’une condition pour retrouver notre place dans la nature. Du global, le « terrestre »retient les formes d’existence qui interdisent de concevoir le problème à l’écart des autres, de se tenir à l’intérieur de quelques frontières que ce soit. Il assume ainsi une hétérogénéité d’identité et ne rejette d’ailleurs pas l’idée des migrations, sans la promouvoir pour autant, mais part du principe que n’importe quel humain qui perd le contact avec la nature, perd son territoire et devient que en quelque sorte un migrant de lui-même.
Pour les « hors sol » , à coup sûr plutôt un capitalocène (terme consacré par tout un pan de la recherche environnementale pour marquer l’empreinte de ce système économique sur la nature) ! Comme le disait Marx dans Le capital, le capitalisme est un système qui ne se développe « qu’en ruinant dans le même temps[en même temps !!] les sources vives de toute richesse : la terre et les travailleurs». Le « libéralocène » précise la notion d’anthropocène en accusant plus le système de valeurs sociales du libéralisme (basées sur la concurrence, la cupidité et la productivité) que les hommes de réellement détruire la planète. La fuite en avant du capitalisme, fuite en avant que l’on retrouve dans toute névrose, se manifeste, à peine la pulsion de propriété satisfaite, dans l’inassouvissement fondamental de la pulsion. L’objet est immédiatement délaissé pour un autre. C’est comme le dit Deleuze contenu dans le capitalisme même, « un système immanent qui ne cesse de repousser ses propres limites et qui les retrouve toujours à une échelle agrandie, parce que la limite, c’est le capitalisme lui-même« . Le libéralisme est fondé sur l’idée de liberté qui va de pair avec l’évolution technologique et l’abondance des biens. Cette liberté, valeur cardinale protégée par l’état, vient néanmoins se heurter à une limite : celle de la nature. Mais aussi celle de la tolérance sociale à ce système. Comment faire en sorte que les citoyens renoncent d’eux même à une liberté sans limite, qui « à force de buter sur la finitude du monde, le fera imploser». Ou, comme le formulerait un psychanalyste, comment assumer cette castration de notre jouissance libérale ?
Doit-on muscler un surmoi extérieur et punitif comme le préconisent les tenants d’une écologie punitive, voire d’une écocratie (Michel Tarnier, Dictature verte), discutée par Hans Jonas dans Le principe de responsabilité. Ou ne doit pas plutôt informer patiemment, refaire les liens de causalité entre nos choix quotidiens et les grandes crises écologiques qui paraissent sinon trop éloignées, puis enfin se responsabiliser pour renoncer de nous-mêmes.
La solution qui apparaît déjà dans les failles de cette mondialisation libérale à bout de souffle, c’est la rotation de l’axe vers le « terrestre », la création d’une autre forme de contrat social où la coopération remplacerait la concurrence, la sobriété l’appétit insatiable, le troc l’achat, la relocalisation des biens agricoles les échanges mondialisés.
Une pensée écologiste et sociale est une idée qui, quand elle sera comprise et connue, sera reconnue.
*on demande souvent des exemples de modèle productiviste vs modèle alternatif: prenons l’exemple de la pêche.
Actuellement est privilégiée au nom de la compétitivité et de la concurrence un modèle, très prisé dans des pays libéraux telle que la Hollande, favorisant une pêche avec gros chalutiers, filets indifférenciés +- électriques qui raclent les fonds océaniques quelque soit la période de l’année (reproduction ou non), avec emplois de véritables mercenaires en CDD au profit de grosses entreprises de pêche financiarisées. La pêche dans le sud de l’Europe peut aussi servir à ramener des poissons dont la transformation en farine nourrira les saumons élevés dans le nord de l’europe.
Le modèle alternatif c’est plus de petits pêcheurs, leur propre patron, moins riches que les patrons du modèle précédent mais plus que leurs mercenaires, respectant par une pêche « douce » le monde marin, ses rythmes, utilisant des filets adaptés, localisant la production.
C’est le triple point G (gagnant-gagnant-gagnant), la nature est respectée (coordonnée écologique), les acteurs gardent le sens de leur métier (coordonnée sociale), et l’efficience économique et l’emploi sont maintenus (coordonnée économique). Il n’y a pas moins d’emploi dans le second modèle. Les richesses y sont seulement mieux réparties.
** Prenons par exemple la résistance des bactéries aux antibiotiques. Cette résistance se nourrit de la pression sélective darwinienne imposée par l’action des antibiotiques sur une population bactérienne. En effet, dans une population bactérienne, les mutants génétiques sont rares mais néanmoins présents dès que la taille de la population est suffisamment importante. Ces mutations rendent résistants aux mécanismes d’action des antibiotiques et sauvent en quelque sorte l’espèce bactérienne grâce à cette sous population qui peut s’adapter et prendre la place. De là deux attitudes médicales s’opposent. L’économie d’antibiotiques, réservés aux situations ou ils sont strictement indispensables, qui évite cette pression et maintient une biodiversité. Ou la fuite en avant consistant à inonder d’antibiotiques toujours plus puissants dans l’espoir fantasmé d’une disparition définitive des bactéries pathogènes et qui aboutit paradoxalement à la création de « monstres » de résistance, un des principaux risques pour la santé humaine actuellement. L’un respecte la complexité et réduit sa marque sur la vie biologique, l’autre l’accroit, pris dans un fantasme prométhéen de suprématie humaine sur le monde microscopique





