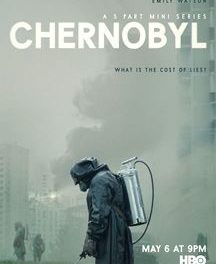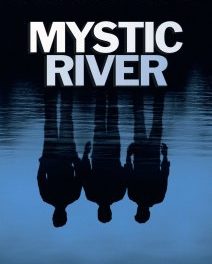L’auteur d’un viol peut rester dans le déni et arguer qu’il s’agissait d’une expérience qui a mal tourné. Ce qui redonne toute sa légitimité au débat sur la notion de consentement…
Mais ici, son auteur ne dénie pas qu’il s’agit d’un viol. Est ce que pour autant tout déni est écarté, comme l’indique la critique de Libération (texte ci-dessous pour les non abonnés à Libé) ?
Non certainement pas et ce dont traite de façon plus profonde le film est un déni plus profond. Faut il se considérer comme une victime pour se sortir du viol ou non ?
Le statut de victime n’est il pas emprisonnant ?
N’est ce pas tout simplement, c’est mon avis, une étape indispensable mais qu’il faut dépasser ?
Cela ne vaut pas que pour les viols mais pour toute autre relation dominant-dominé et il n’en manque pas.
Bonne vision et bonne lecture
Libération – «Comme si de rien n’était», intime building –
Par Elisabeth Franck-Dumas 2 avril 2019 à 17:56
Comme si de rien n’était, premier long métrage et film de fin d’étude de l’Allemande Eva Trobisch, 35 ans, serait un film déplaisant si le pitch de son dossier de presse résumait son intention. A savoir : une femme «moderne, éduquée, rationnelle», Janne, se fait violer lors d’une réunion d’anciens de l’école. «Mais elle va persister à faire semblant que tout va bien, refuser de se considérer comme une victime et perdre le contrôle… Jusqu’à quand ?» Ce résumé sous-entend que le ressort du film serait celui de l’attente d’une chute, ressort qui ferait de nous, spectateurs, des voyeurs attendant perversement que l’héroïne pète un câble (et démontre ainsi que victime, elle l’est sûrement). Ce serait une manière d’avaliser l’idée démontée par Virginie Despentes dans son crucial King Kong Théorie, à savoir que la société attend d’abord des victimes de viol qu’elles soient «traumatisée[s]». Si l’écrivaine ne niait pas dans ses pages que le viol était «quelque chose qu’on attrape et dont on ne se défait plus, inoculé», elle décrivait aussi le coup de tonnerre qu’avait été pour elle la lecture d’un texte de Camille Paglia dédramatisant l’affaire : «Plutôt que d’avoir honte d’être vivantes, on pouvait décider de se relever et de s’en remettre le mieux possible.»
Cette possibilité est-elle envisageable, vivable, souhaitable ? C’est ce que demande, froidement et sans pathos, le film d’Eva Trobisch, d’une manière subtile et ouverte qu’on pourrait résumer ainsi : on ne sent pas, dès les premiers moments du film, qu’il détient la réponse et va nous l’asséner. Cela tient, entre autres, à la qualité du regard qu’il pose sur son héroïne, dénué de tout jugement, et à la manière dont il scrute son corps, jamais inutilement sexualisé, ni pris en pitié, mais vu comme acteur y compris sous la contrainte. Ne serait-ce que dans cette ahurissante scène de viol, antispectaculaire au possible, où Janne, dépassée physiquement par un corps plus grand et costaud que le sien, garde ce qui lui reste de maîtrise en balançant son mépris au visage de l’agresseur : «Tu es sérieux, là ?» Il ne nous semble jamais avoir vu au cinéma une telle scène respectant à ce point la victime, sans jamais sacrifier à la vraisemblance. Le jeu des deux comédiens, Aenne Schwarz, silhouette frêle et tendue qui compose avec une partition d’infimes aigus, et Hans Löw (In My Room), qui fait de l’agresseur un pathétique cadre sup réprimé, y est pour beaucoup.
Fossé générationnel
L’ouverture du film trouve Janne dans un magasin de bricolage, en train de contempler une vidéo promotionnelle de dalles de sol. La qualité et le scénario du spot avoisinent celle d’un porno cheap : une femme derrière ses fourneaux se lamente de l’arrivée de jambes poilues et masculines, chaussées de crampons boueux, sur le sol de sa belle cuisine. L’indice n’a rien d’appuyé, car Eva Trobisch a la main légère, mais l’on y songera plus tard, ce détail venant s’adjoindre à un faisceau d’autres notations (au hasard, cette Nora que l’héroïne va voir au théâtre) formant autant de réponses au véritable suspense du film : pourquoi Janne décide-t-elle, en 2019, à l’ère de #MeToo, de ne «pas en faire tout un plat» de l’agression qu’elle a subie ? Et ce, en dépit des admonitions tardives d’une mère lui expliquant que «non, c’est non» ? Le fossé générationnel creusé par le contraste est l’une des pistes s’offrant à notre réflexion.
Editrice dans une petite maison en faillite qu’elle a montée avec son compagnon Piet (Andreas Döhler), Janne, spécimen de ces «classes créatives» minées par toutes sortes de révolutions numériques et commerciales, vient d’emménager à la campagne, où le couple retape une maison prêtée. Elle en est à ce stade de vulnérabilité lorsqu’elle se voit proposer un remplacement de congé maternité dans une grande maison commerciale, l’éditrice enceinte étant arrêtée en raison de «kystes utérins» (car, vraiment, rien ne doit être passé sous silence des faiblesses et dysfonctionnements des corps féminins). Janne gardait jadis les enfants de l’homme qui lui fait cette proposition, et bientôt, elle sera violée par le beau-frère de cet employeur potentiel, lors d’une soirée arrosée. Janne ne parle à personne du viol et décide de prendre le poste, à la fureur de son compagnon, qui le vit comme un abandon.
Ces bases ont sur le papier quelque chose d’un peu fabriqué, mais elles sont déclinées avec naturel et fluidité, sans doute car Trobisch parvient à un équilibre entre l’anodin et le sursignifiant, une sorte d’apnée généralisée qui fait de son geste le témoignage distancié des situations qu’elle orchestre. Et si le scénario peut être lu comme une machine enfermant peu à peu son personnage (avec un ultime rebondissement un peu regrettable), il offre un arrière-plan social, économique et politique texturé à la condition de Janne. Ce n’est ainsi pas un hasard que le beau-frère violeur s’occupe dans la boîte d’une «fusion» entre deux services (la réunion forcée de deux corps, ça le connaît), pas non plus un hasard que le boss soit violenté par sa propre compagne parce qu’il n’arrive pas à procréer (l’impératif social pesant sur les femmes revenant en boomerang sur l’homme plus vieux). Les rapports de domination, y compris économique, l’entremêlement de l’intime et du professionnel qui en découle, les assignations genrées, tout cela est finement balayé par le film. Et l’enfermement dans lequel Janne se vit trouve une forme dans des plans au cordeau qui la cadrent presque toujours entre deux murs, ou coincée entre un corps d’homme et un meuble, ou entre deux corps d’hommes, bref toujours empêchée.
«Boy next door»
La dernière chose qui n’a rien de caricatural, mais plutôt de banal, c’est ce violeur, boy next door aux yeux de cocker et à la mine contrite. Sa vie est une suite tranquille de privilèges dont il jouit sans conscience, jusqu’à ce qu’il décide de s’en arroger un grâce à la violence physique. Ses atermoiements sont importants, car ils soulignent l’absence d’ambiguïté de la situation : lui non plus n’envisage pas ce qui s’est passé autrement qu’un viol, même si le mot n’est jamais prononcé. Il n’y a pas de déni, pas de «zone grise», pour reprendre une expression popularisée par la journaliste Blandine Grosjean dans un documentaire l’an dernier. Dans un long article qui l’accompagnait paru dans le Monde, elle revenait sur ces relations non consenties qu’elle avait commencé par qualifier de «mauvaises expériences» avant de revoir son jugement et s’interroger sur la notion de consentement. Elle y appelait écrivains, journalistes et cinéastes, à «mettre des mots, des images sur « ça », en se gardant bien de victimiser celles qui ne se sentent pas victimes». Il semble qu’Eva Trobisch s’y est employée.Elisabeth Franck-Dumas